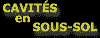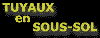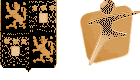|

Vue générale
de Lille (1900)

Gustave
DELORY, maire de Lille (1886-1890)

L'explosion
des casernes de Moulins (1916)
|
|
 Lille
industrielle, Lille patriote mais aussi Lille ouvrière, misérable :
ce cimetière, créé en 1864, est un reflet précieux
de la mémoire lilloise. Comme dans une mosaïque, les destins individuels,
brillants ou humbles, s'imbriquent pour composer l'histoire collective. Lille
industrielle, Lille patriote mais aussi Lille ouvrière, misérable :
ce cimetière, créé en 1864, est un reflet précieux
de la mémoire lilloise. Comme dans une mosaïque, les destins individuels,
brillants ou humbles, s'imbriquent pour composer l'histoire collective.
 Une fois passée la grande arche, les bruits de la ville s'assourdissent, l'atmosphère se fait feutrée. Entre ses murs, à l'abri de ses arbres, le cimetière se tait. La grille s'ouvre sur la partie la plus ancienne
du lieu. Les allées y sont tortueuses, les sépultures un peu désordonnées.
Une fois passée la grande arche, les bruits de la ville s'assourdissent, l'atmosphère se fait feutrée. Entre ses murs, à l'abri de ses arbres, le cimetière se tait. La grille s'ouvre sur la partie la plus ancienne
du lieu. Les allées y sont tortueuses, les sépultures un peu désordonnées.
 Désiré Verhaeghe repose là, près de l'entrée. Au début du XXe siècle, en pleine révolution industrielle, ce médecin est un pionnier de la lutte contre la tuberculose. Disciple de Pasteur et de Guesde, il lutte inlassablement contre cette maladie liée aux misérables conditions de travail des ouvriers. Il travaille avec des hommes du peuple et prêche l'hygiène dans les taudis. A sa mort, la municipalité finance sa tombe et la statue qui la surplombe. Le savant contemple désormais ses visiteurs d'un air débonnaire à travers son
curieux lorgnon métallique.
Désiré Verhaeghe repose là, près de l'entrée. Au début du XXe siècle, en pleine révolution industrielle, ce médecin est un pionnier de la lutte contre la tuberculose. Disciple de Pasteur et de Guesde, il lutte inlassablement contre cette maladie liée aux misérables conditions de travail des ouvriers. Il travaille avec des hommes du peuple et prêche l'hygiène dans les taudis. A sa mort, la municipalité finance sa tombe et la statue qui la surplombe. Le savant contemple désormais ses visiteurs d'un air débonnaire à travers son
curieux lorgnon métallique.
Ouvriers et patrons,
côte à côte
 Dans l'allée voisine se trouve la tombe en marbre blanc de Gustave Delory. Ce célèbre syndicaliste est maire de Lille de 1896 à 1900. Ardent porte-parole de la cause ouvrière, il commence comme peigneur dans une industrie textile, et finit sur les bancs de l'Assemblée Nationale. Il est avec Jules Guesde l'un des fondateurs du Parti ouvrier. Dans l'allée voisine se trouve la tombe en marbre blanc de Gustave Delory. Ce célèbre syndicaliste est maire de Lille de 1896 à 1900. Ardent porte-parole de la cause ouvrière, il commence comme peigneur dans une industrie textile, et finit sur les bancs de l'Assemblée Nationale. Il est avec Jules Guesde l'un des fondateurs du Parti ouvrier.
 Au tour des patrons : parmi quelques stèles modestes s'élève
le caveau de la famille Thiriez. Cette dynastie de la filature a animé
la vie industrielle locale à la fin du XIXe siècle. Le monument
est à l'image de la lignée : imposant, riche. Il rappelle
le pouvoir d'Alfred Thiriez à partir de 1889, ce mélange
d'esprit d'entreprise et de paternalisme caractéristique des grands
manufacturiers de son époque.
Au tour des patrons : parmi quelques stèles modestes s'élève
le caveau de la famille Thiriez. Cette dynastie de la filature a animé
la vie industrielle locale à la fin du XIXe siècle. Le monument
est à l'image de la lignée : imposant, riche. Il rappelle
le pouvoir d'Alfred Thiriez à partir de 1889, ce mélange
d'esprit d'entreprise et de paternalisme caractéristique des grands
manufacturiers de son époque.
Cicatrices de la guerre
 Quelques
pas de plus suffisent pour découvrir le "carré des dix-huit
ponts." Ni statuaire imposante ni marbre monumental, mais des rangées
de croix toutes simples, bien alignées dans l'herbe. Le 11 janvier
1916, les casernes de Moulins, dites "des dix-huit ponts", explosent.
Le quartier est détruit et l'on relève une centaine de cadavres.
La ville de Lille fait l'acquisition d'une parcelle pour accueillir les
victimes civiles. Le carré sera ensuite ouvert à toutes
les victimes de guerre. Le martyre des populations civiles en temps de
guerre fait enfin l'objet d'une reconnaissance officielle, auparavant
réservée aux militaires. Quelques
pas de plus suffisent pour découvrir le "carré des dix-huit
ponts." Ni statuaire imposante ni marbre monumental, mais des rangées
de croix toutes simples, bien alignées dans l'herbe. Le 11 janvier
1916, les casernes de Moulins, dites "des dix-huit ponts", explosent.
Le quartier est détruit et l'on relève une centaine de cadavres.
La ville de Lille fait l'acquisition d'une parcelle pour accueillir les
victimes civiles. Le carré sera ensuite ouvert à toutes
les victimes de guerre. Le martyre des populations civiles en temps de
guerre fait enfin l'objet d'une reconnaissance officielle, auparavant
réservée aux militaires.
 Au
hasard des allées, on ne croise pas seulement des destinées
tragiques. L'histoire de Charles Bacqueville illustre une joyeuse tradition
de la vie lilloise : les fanfares. L'homme moustachu aux joues rebondies,
représenté en médaillon sur la stèle, était
une vedette du cornet à piston dans les années 1890. Ses
compagnons de fanfare ont financé sa sépulture, en hommage
à ce genre musical si populaire. Au
hasard des allées, on ne croise pas seulement des destinées
tragiques. L'histoire de Charles Bacqueville illustre une joyeuse tradition
de la vie lilloise : les fanfares. L'homme moustachu aux joues rebondies,
représenté en médaillon sur la stèle, était
une vedette du cornet à piston dans les années 1890. Ses
compagnons de fanfare ont financé sa sépulture, en hommage
à ce genre musical si populaire.
L'Internationale : une si longue imposture
 Autre
musicien, autre histoire, moins gaie celle-là. Dans un coin du
cimetière, une dalle polie par le temps disparaît sous les
buissons : c'est là que repose Adolphe Degeyter, longtemps
considéré comme le compositeur de l'Internationale.
En 1883, c'est pourtant son frère Pierre qui écrit la musique
de l'hymne ouvrier. Mais une confusion intervient. Le public ne retient
que le nom d'Adolphe, qui a le premier prêté sa voix au chant
révolutionnaire. Autre
musicien, autre histoire, moins gaie celle-là. Dans un coin du
cimetière, une dalle polie par le temps disparaît sous les
buissons : c'est là que repose Adolphe Degeyter, longtemps
considéré comme le compositeur de l'Internationale.
En 1883, c'est pourtant son frère Pierre qui écrit la musique
de l'hymne ouvrier. Mais une confusion intervient. Le public ne retient
que le nom d'Adolphe, qui a le premier prêté sa voix au chant
révolutionnaire.
 Adolphe
joue le jeu, pour punir son aîné d'avoir quitté le
Parti ouvrier. Jusqu'à ce qu'il se suicide, laissant une lettre
qui désigne Pierre comme seul compositeur de la fameuse musique.
Cette fin tragique prend une tournure encore plus pathétique en
1922 : la Cour d'appel de Paris ordonne que soit effacée sur
la tombe d'Adolphe Degeyter toute référence à l'Internationale. Adolphe
joue le jeu, pour punir son aîné d'avoir quitté le
Parti ouvrier. Jusqu'à ce qu'il se suicide, laissant une lettre
qui désigne Pierre comme seul compositeur de la fameuse musique.
Cette fin tragique prend une tournure encore plus pathétique en
1922 : la Cour d'appel de Paris ordonne que soit effacée sur
la tombe d'Adolphe Degeyter toute référence à l'Internationale.
 Tous ces parcours individuels se croisent pour composer la photographie
du Lille du XIXe siècle. Le cliché n'est pas complet, il
est un peu jauni, mais on y distingue bien les ombres et les contrastes.
Et paradoxalement, entre les tombes et les caveaux, c'est de vies que
nous parle ce cimetière. De ces vies longues ou courtes, misérables
ou faciles, glorieuses ou anonymes, qui font l'histoire d'une ville.
Tous ces parcours individuels se croisent pour composer la photographie
du Lille du XIXe siècle. Le cliché n'est pas complet, il
est un peu jauni, mais on y distingue bien les ombres et les contrastes.
Et paradoxalement, entre les tombes et les caveaux, c'est de vies que
nous parle ce cimetière. De ces vies longues ou courtes, misérables
ou faciles, glorieuses ou anonymes, qui font l'histoire d'une ville.
|



![]()
![]()