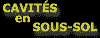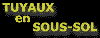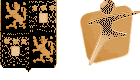|
 Lille
n'a pas été bâtie en un jour. Lille n'a pas non plus
été bâtie n'importe où et sur n'importe quoi.
Les premiers coups de pioches dans notre sous-sol le démontrent
(cf. carte). La ville de Lille est située sur une nappe crayeuse
profonde d'une quarantaine de mètres - le « Pont crayeux
du Mélantois » (en jaune sur la carte). Lille
n'a pas été bâtie en un jour. Lille n'a pas non plus
été bâtie n'importe où et sur n'importe quoi.
Les premiers coups de pioches dans notre sous-sol le démontrent
(cf. carte). La ville de Lille est située sur une nappe crayeuse
profonde d'une quarantaine de mètres - le « Pont crayeux
du Mélantois » (en jaune sur la carte).
 Cette
nappe de craie s'est constitué entre - 100 et - 60 millions
d'années alors que la mer recouvrait notre Bas-Pays. Elle est composée,
en surface, d'une première couche de craie "tendre" ou craie blanche.
Celle-ci surplombe une couche de craie plus dure ou craie grise, elle
même située au dessus d'une épaisse couche de marnes crayeuses
imperméables. Alors qu'au sud de la ville, cette nappe de craie
affleure (quartiers de Lille sud, ville de Fâches-Thumesnil), au
nord elle s'enfonce sous une couche d'argile des Flandres (en rouge) épaisse
d'une dizaine de mètres. Cette
nappe de craie s'est constitué entre - 100 et - 60 millions
d'années alors que la mer recouvrait notre Bas-Pays. Elle est composée,
en surface, d'une première couche de craie "tendre" ou craie blanche.
Celle-ci surplombe une couche de craie plus dure ou craie grise, elle
même située au dessus d'une épaisse couche de marnes crayeuses
imperméables. Alors qu'au sud de la ville, cette nappe de craie
affleure (quartiers de Lille sud, ville de Fâches-Thumesnil), au
nord elle s'enfonce sous une couche d'argile des Flandres (en rouge) épaisse
d'une dizaine de mètres.
 Entre
l'argile au nord et la craie au sud, la Deûle a déposé
une fine couche d'alluvions (en vert). Ajoutez à cela quelques
limons superficiels (en hachures sur la carte), des dépôts
de sables et quelques filons de grès et vous aurez un aperçu
des différents matériaux qui composent le sous-sol lillois. Entre
l'argile au nord et la craie au sud, la Deûle a déposé
une fine couche d'alluvions (en vert). Ajoutez à cela quelques
limons superficiels (en hachures sur la carte), des dépôts
de sables et quelques filons de grès et vous aurez un aperçu
des différents matériaux qui composent le sous-sol lillois.
Des p'tits trous,
des p'tits trous...
dans le sous-sol
 Avec
tout cela, pas de quoi bâtir une ville. Et bien si ! Il suffit de
déambuler dans les rues du vieux Lille pour admirer la richesse
et la diversité de notre sous-sol : le grès utilisé
pour les soubassements des maisons, la craie la plus dure pour les encadrements
des fenêtres, les argiles pour la fabrication des briques et la
craie de moins bonne qualité pour le remplissage des murs comme
à la citadelle par exemple. Avec
tout cela, pas de quoi bâtir une ville. Et bien si ! Il suffit de
déambuler dans les rues du vieux Lille pour admirer la richesse
et la diversité de notre sous-sol : le grès utilisé
pour les soubassements des maisons, la craie la plus dure pour les encadrements
des fenêtres, les argiles pour la fabrication des briques et la
craie de moins bonne qualité pour le remplissage des murs comme
à la citadelle par exemple.
 Un
art de bâtir si réputé qu'il faisait des maisons lilloises
au XVIIe siècle, des modèles de modernité alors que,
dans bon nombre de villes françaises, on utilisait encore la technique
du colombage. Au XIXe siècle, l'usage de la craie s'étend
à d'autres domaines : le chaulage des champs, le raffinage
du sucre. La craie lilloise était devenue multi-usage. Un
art de bâtir si réputé qu'il faisait des maisons lilloises
au XVIIe siècle, des modèles de modernité alors que,
dans bon nombre de villes françaises, on utilisait encore la technique
du colombage. Au XIXe siècle, l'usage de la craie s'étend
à d'autres domaines : le chaulage des champs, le raffinage
du sucre. La craie lilloise était devenue multi-usage.
 Du
moyen-âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le sous-sol
lillois a ainsi été criblé de trous. Dès le
XIe siècle, des carrières souterraines ont perforé
le sous-sol permettant, par exemple, la construction de la Collégiale
Saint-Pierre. Au XVIIe siècle, une épidémie de peste
oblige même Vauban à ouvrir de nouvelles carrières
dans le quartier de Wazemmes et de la rue d'Esquermes. Du
moyen-âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le sous-sol
lillois a ainsi été criblé de trous. Dès le
XIe siècle, des carrières souterraines ont perforé
le sous-sol permettant, par exemple, la construction de la Collégiale
Saint-Pierre. Au XVIIe siècle, une épidémie de peste
oblige même Vauban à ouvrir de nouvelles carrières
dans le quartier de Wazemmes et de la rue d'Esquermes.
 Depuis
près de deux siècles, plus aucune de ces carrières
n'est en activité pour l'exploitation de la craie. La faible profondeur
de la nappe phréatique et le progressif remplacement de la craie
par la brique comme matériau de construction explique cet abandon. Depuis
près de deux siècles, plus aucune de ces carrières
n'est en activité pour l'exploitation de la craie. La faible profondeur
de la nappe phréatique et le progressif remplacement de la craie
par la brique comme matériau de construction explique cet abandon.
 Pourtant, les traces de cet usage passé de notre sous-sol persistent.
Les carrières inexploitées s'étendent encore sur
près de 250 hectares dans le seul arrondissement de Lille. Ni
or ni pétrole donc, mais de l'eau, de la craie et de l'air dans
les carrières. Tels sont les ingrédients d'une richesse
géologique à la lilloise.
Pourtant, les traces de cet usage passé de notre sous-sol persistent.
Les carrières inexploitées s'étendent encore sur
près de 250 hectares dans le seul arrondissement de Lille. Ni
or ni pétrole donc, mais de l'eau, de la craie et de l'air dans
les carrières. Tels sont les ingrédients d'une richesse
géologique à la lilloise.
|



![]()
![]()